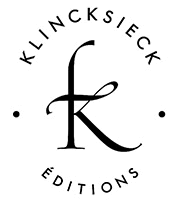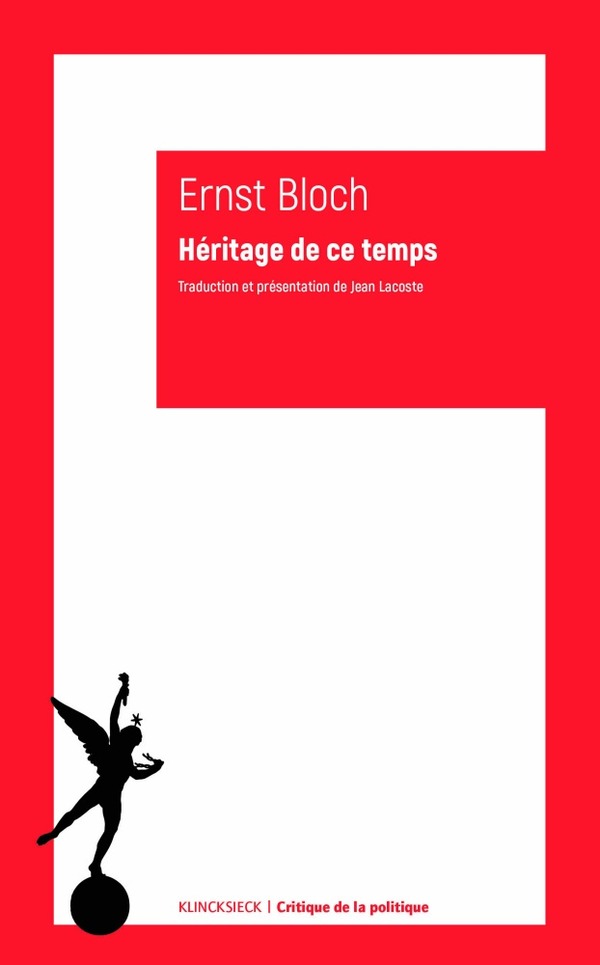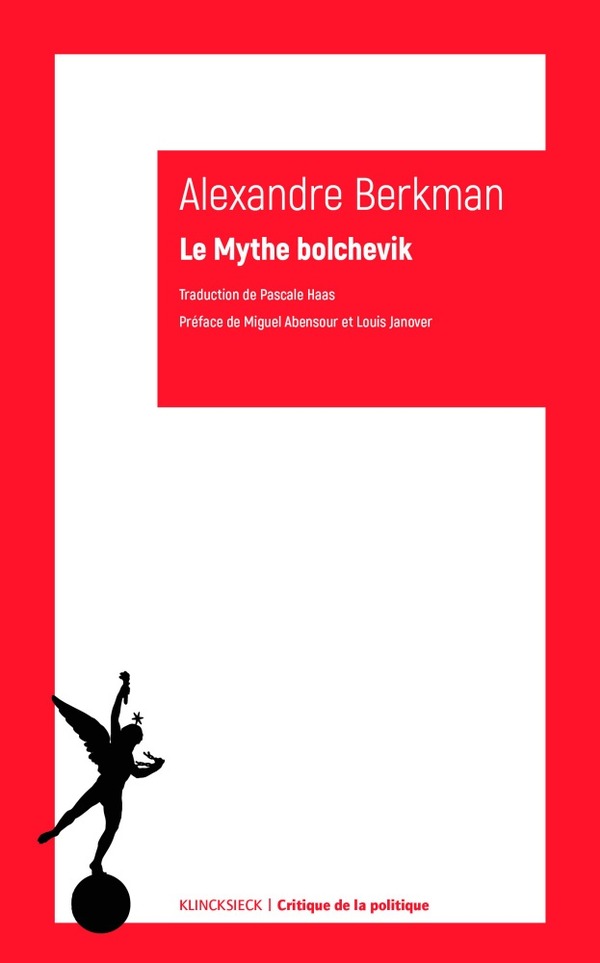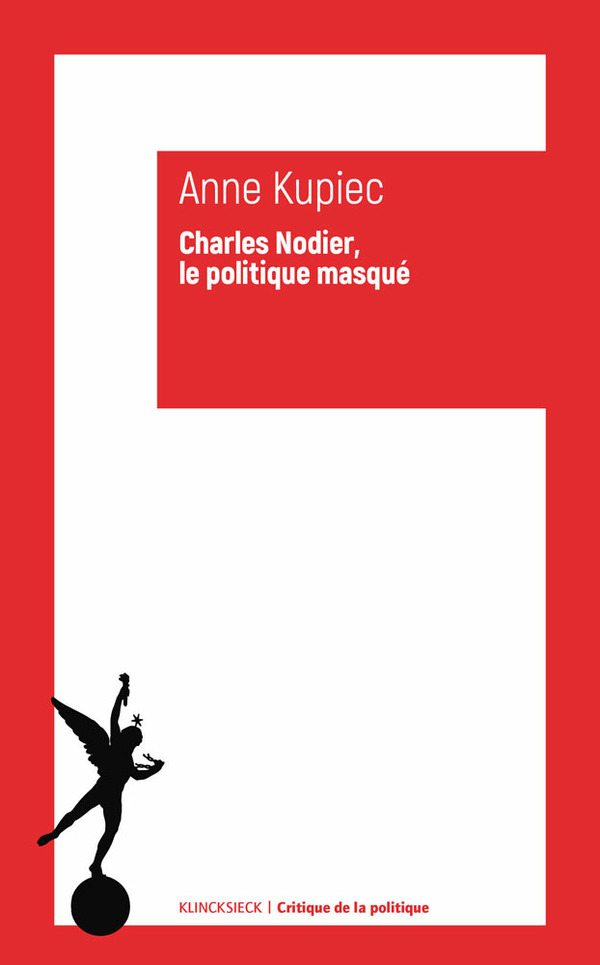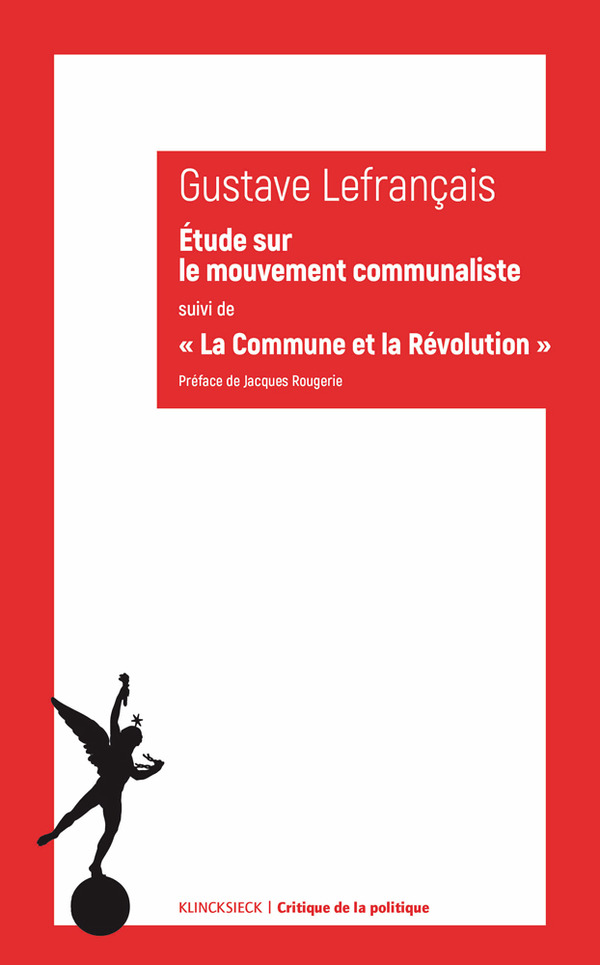Experimentum mundi
Question, catégories de l’élaboration, praxis
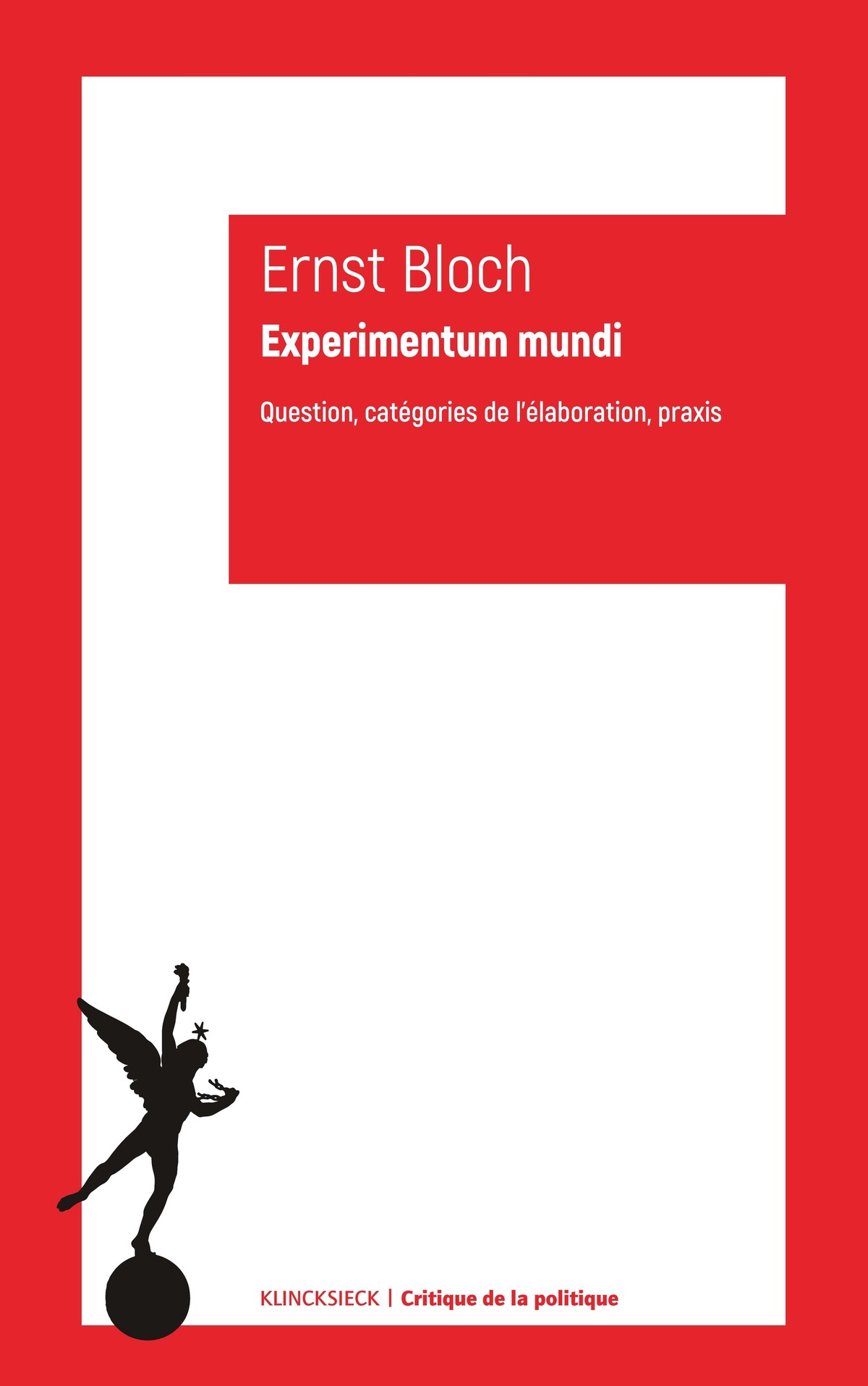
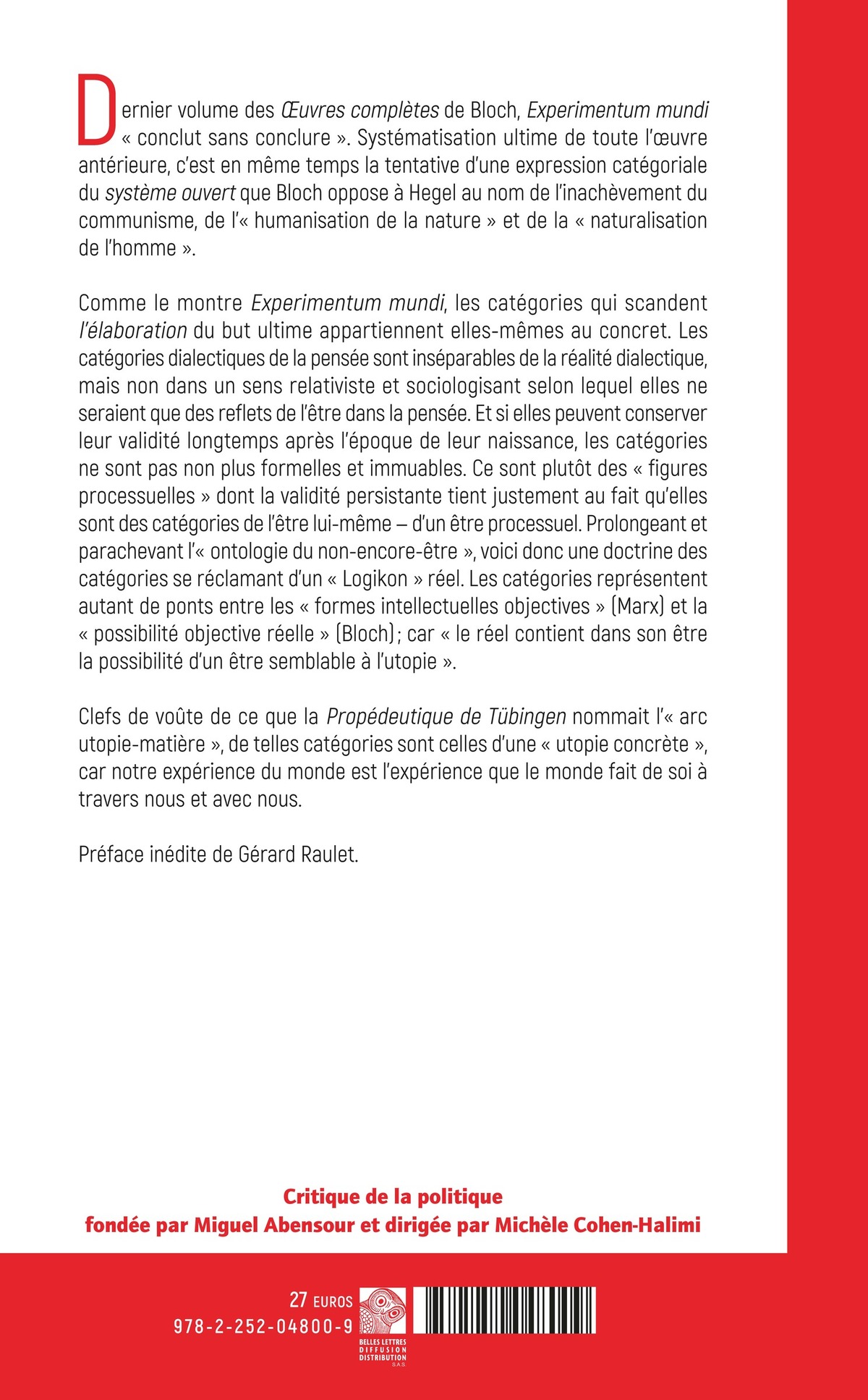
- 294 pages
- Index
- Livre broché
- 14 x 22 cm
- Critique de la politique
- N° dans la collection : 39
- Parution : 05/03/2025
- CLIL : 3289
- EAN13 : 9782252048009
- Code distributeur : 76815
Préface, traduction et notes de Gérard Raulet.
Extrait Audio
Présentation
Dernier volume des OEuvres complètes de Bloch, Experimentum mundi « conclut sans conclure ». Systématisation ultime de toute l’oeuvre antérieure, c’est en même temps la tentative d’une expression catégoriale du système ouvert que Bloch oppose à Hegel au nom de l’inachèvement du communisme, de l’« humanisation de la nature » et de la « naturalisation de l’homme ».
Comme le montre Experimentum mundi, les catégories qui scandent l’élaboration du but ultime appartiennent elles-mêmes au concret. Les catégories dialectiques de la pensée sont inséparables de la réalité dialectique, mais non dans un sens relativiste et sociologisant selon lequel elles ne seraient que des reflets de l’être dans la pensée. Et si elles peuvent conserver leur validité longtemps après l’époque de leur naissance, les catégories ne sont pas non plus formelles et immuables. Ce sont plutôt des « figures processuelles » dont la validité persistante tient justement au fait qu’elles sont des catégories de l’être lui-même — d’un être processuel. Prolongeant et parachevant l’« ontologie du non-encore-être », voici donc une doctrine des catégories se réclamant d’un « Logikon » réel. Les catégories représentent autant de ponts entre les « formes intellectuelles objectives » (Marx) et la « possibilité objective réelle » (Bloch) ; car « le réel contient dans son être la possibilité d’un être semblable à l’utopie ».
Clefs de voûte de ce que la Propédeutique de Tübingen nommait l’« arc utopie-matière », de telles catégories sont celles d’une « utopie concrète », car notre expérience du monde est l’expérience que le monde fait de soi à travers nous et avec nous.
Biographies Contributeurs
Ernst Bloch
Ernst Bloch (1885-1977) a très tôt adhéré au socialisme et a fait campagne contre le militarisme prussien. En 1915, il part pour la Suisse où, pendant toute la guerre, il défend des positions anti-impérialistes. Rentré en Allemagne, il publie en 1918 L'Esprit de l'utopie, un des grands livres du marxisme non orthodoxe. En 1922, il publie sa thèse consacrée à Thomas Munzer. Il attaque de plus en plus violemment le nazisme et publie en 1935 L'Héritage de ce temps, ouvertement antinazi. Déchu de la nationalité allemande et exposé aux persécutions antisémites, il quitte l'Allemagne et part pour New York. À la fin de la guerre, il revient en Europe, en Allemagne de l'Est, et occupe la chaire KarlMarx à l'université de Leipzig. Il commence à faire paraître son opus magnum, Le Principe espérance (trois tomes, 1954-1959). D'abord salué par les autorités de la RDA, il est ensuite accusé de professer un marxisme hérétique et de « corrompre la jeunesse ». En 1961, il quitte la RDA et achève sa carrière à l'université de Tübingen.
Gérard Raulet
Philosophe, germaniste et traducteur, Gérard Raulet a contribué par ses nombreuses publications et traductions à faire connaître en France, dès les années 1970, tout un pan de la philosophie allemande. Professeur d’histoire des idées allemandes à la Sorbonne et fondateur du Groupe de recherche sur la culture de Weimar, il a publié des ouvrages sur la pensée d’Ernst Bloch, de Herbert Marcuse, mais aussi de Kant et de Marx. Spécialiste internationalement reconnu de Walter Benjamin, il lui a consacré de nombreux travaux qui font autorité et a notamment proposé, outre sa nouvelle édition de Sur le concept d’histoire, une lecture très approfondie de ce texte dans le dernier chapitre de son ouvrage Le Caractère destructeur. Esthétique, théologie et politique chez Walter Benjamin (Aubier, 1997). Il a publié en 2020 un ouvrage consacré aux relations entre Benjamin et les écrivains et intellectuels français (Das befristete Dasein der Gebildeten : Benjamin und die französische Intelligenz, Konstanz University Press).